What is a woman ? de Matt Walsh, et le symbolisme du questionnement
La définition impossible des notions de genre
Matt Walsh est l’un des journalistes vedettes du Daily Wire, média conservateur états-unien né sur YouTube en réaction à l’émergence de la politique dite « woke ». Le terme « woke », désigne généralement les théories politico-sociales qui se concentrent sur la défense des minorités et la déconstruction des normes traditionnelles, perçues comme des « structures d’oppression ». Sur la chaîne du Daily Wire, Walsh s’emploie particulièrement à combattre ce qu’il appelle la « trans-idéologie », c’est-à-dire le sous-bassement épistémologique et éthique de la notion de « trans-identité ».
La « trans-identité » est l’identité d’une personne qui pense appartenir à un autre genre que celui qu’on lui a assigné à la naissance, en se fiant à son sexe. L’identité sexuelle est généralement déterminée par le type de gamètes que le corps d’un individu peut ou pourrait produire. Le sexe féminin et le sexe masculin sont donc des faits biologiques observables. Le mot « genre » est plus difficile à définir, comme on va le voir. Dans le sens où on l’utilise habituellement, il est censé recouvrir un ensemble identifié de comportements et de rapports sociaux. Les adjectifs « mâle » et « femelle » désigneraient ainsi l’identité sexuelle, tandis que les adjectifs « masculin » et « féminin » désigneraient l’identité sociale. Quand un individu de sexe mâle pense ou souhaite être reconnu comme un individu « féminin », il y a trans-identité (et de même dans le sens inverse, évidemment)[1].
La trans-identité naît donc d’une auto-détermination. Or, toute définition est une entrave à l’auto-détermination, car toute définition est une limitation[2]. Une définition ne peut se référer qu’à une essence ou à une généralisation : soit la définition de « femme » désigne l’essence de la féminité plus ou moins bien manifestée à travers les femmes individuelles, soit elle englobe la liste des caractéristiques communes aux individus pouvant être appelés des « femmes ». Ces deux types de définitions sont des limitations. Elles opposent toutes deux des critères objectifs aux tentatives d’appropriation abusives. L’individu qui se réclame d’une définition sans y correspondre nie la réalité s’il s’agit d’une définition essentialiste, ou le sens des mots s’il s’agit d’une définition nominaliste. Confrontés à ces limitations, les défenseurs de la notion de trans-identité pourraient proscrire d’avance les définitions de la masculinité et de la féminité pour que ces deux mots soient à la disposition de chacun, comme le sont les noms propres. Après tout, si la féminité ne peut être déterminée ni par la biologie – ce qui exclurait les « femmes transgenres » – ni par les normes sociales – ce qui livrerait l’identité féminine au jugement de la société – les notions de genre deviennent des espaces vides où tout le monde peut s’installer sans présenter de justificatifs.
Mais évidemment, l’écroulement des définitions de genre ôterait à la trans-identité tout son sens, qui repose précisément sur la mise en opposition du genre et du sexe. En somme, les mots « genre », « homme » et « femme » doivent avoir des définitions assez indiscutables pour justifier des opérations lourdes et une refonte des normes sociales, mais aussi assez vagues pour que chacun puisse les invoquer sans restriction. Sans la masculinité et la féminité, l’homme (biologiquement parlant) qui affirme être une femme ne peut plus expliquer ce que signifie « être une femme ». D’autres constructions idéologiques sont d’ailleurs emportées dans le collapsus, dont le féminisme moderne et toutes les lettres du mouvement LGBT[3]. La défense des trans-identités doit donc faire des allers-retours incessants entre une définition du genre comme « identité fondamentale » des personnes trans et comme « construction sociale arbitraire » de la société transphobe.
« What is a woman ? », est une succession d’entretiens avec des militants de la cause transgenre qui tentent de se dépêtrer de ce paradoxe. Comment sait-on qu’on appartient à un genre plutôt qu’à un autre, si cette appartenance n’est soumise à aucun critère objectif ? Et si ces critères sont entièrement à la discrétion des individus, pourquoi faire entrer dans la loi le juste emploi de mots qui ont un sens différent pour chaque personne ?
Après la sortie du documentaire, la question « Qu’est-ce qu’une femme ? », scandée lors d’assemblées politiques ou posée à des personnalités pendant des émissions de télévision, a revêtu un intéressant statut de « question piège » qui soulève en général l’indignation de la gauche américaine. Mais on oublie souvent que cette question a d’abord été posée par ceux-là même qui en récusent aujourd’hui la pertinence. L’histoire de la « théorie queer » (où Walsh inclurait la « trans-idéologie ») est effet constellée de questions semblables destinées à mettre en lumière la précarité des définitions employées par les personnes dites « normales » (« cisgenres », « binaires », « hétéronormées ») dont l’identité ou l’orientation sexuelle sont socialement acceptées. Les penseurs et les activistes de ces mouvements contestataires entendaient justement remettre en question les certitudes d’individus dont ils estimaient le comportement trop conforme à la norme sociale. Cette subversion n’était pas seulement dialectique : elle s’incarnait dans des pratiques nocturnes, souterraines et marginales comme le cross-dressing, le drag, etc. L’esprit conservateur s’indignait de ces attaques contre le bon sens et l’ordre social. Cependant, elles étaient pour ainsi dire dans l’ordre des choses.
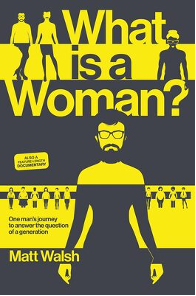
La légitimité des questions périphériques
Dans le symbolisme traditionnel, et particulièrement dans le symbolisme biblique, le questionnement vient de la « terre », masse informe à la recherche d’un sens. La réponse vient du « ciel », producteur de principes abstraits s’incarnant dans le monde terrestre. C’est Adam – l’humanité – qui sert de médiateur entre ces deux pôles. Dans la Genèse, Adam nomme les animaux (Gen 2:20) : sa parole, c’est-à-dire son souffle (son « ciel intérieur »), organise la matière terrestre indéterminée, « questionnante », en lui donnant pour réponse les principes célestes. Sans les questions de la terre, les réponses du ciel, et l’intercession d’Adam entre les deux, le monde n’existerait pas ; car le chaos « d’en bas » ne pourrait s’organiser en structures, et les principes « d’en haut » ne pourraient se matérialiser de manière tangible. Lorsque par l’intercession de l’humanité, les réponses du ciel sont données aux questions de la terre, un « système » ou une « structure » prend forme. Mais la médiation adamique a été blessée par le péché originel. Adam ne peut se tenir perpétuellement et naturellement entre le ciel et la terre. Maudit, il est désormais condamné à « mourir de mort » (Gen 2:17), et à « retourner à la poussière » (Gen 3:19) : son ciel intérieur et la boue dont il est fait finiront par se séparer. La création elle-même étant affectée par la chute, Adam doit désormais la corriger en la travaillant « à la sueur de son front » (Gen 3:19), sans quoi elle ne lui permettra pas de maintenir son rôle central bien longtemps. Pour persister dans cet effort, il doit s’aider de technologies, c’est à dire d’artifices qui maintiennent la médiation quand il chancelle. La première de ces technologies est sans doute l’emploi des feuilles de figuier cousues (Gen 3:7) avec lesquelles Adam et Eve cachent leur vulnérabilité de créatures déchues.
Dans le cas qui nous intéresse, ces technologies sont les fameuses « normes sociales » (vêtements, rôles, attitudes, etc.) : elles sont ce que la sociologie appelle le « genre ». Par la médiation artificielle de la société, l’individu animal, sexué, est ordonné à son « identité céleste ». Le terme « genre » peut donc désigner trois catégories différentes : le genre terrestre, biologique (le sexe), le genre céleste, métaphysique, et, entre les deux, le genre « artificiel » et médiateur, c’est à dire social. Si la médiation artificielle est rejetée, l’interpénétration de la « matière animale » et de « l’identité céleste » ne peut s’opérer, et l’individu qui en résulte est une brute sans âme ou un esprit impotent[4]. Ce schéma ne laisse pas de place au débat moderne qui oppose constructivistes et essentialistes. Le « construit » est construit précisément pour médier entre une « essence » et son exemplaire. Inversement, « l’essence » ne peut se manifester qu’à travers le construit. En opposant les « constructions sociales » à une identité « réelle » qui en serait indépendante, on se prive du seul canal par lequel les mystères de l’existence peuvent être illuminés dans le monde d’après la Chute.
Mais le même appareillage normatif qui permet l’information par le principe céleste, empêche dans le même temps l’accès direct au principe céleste. La médiation artificielle est une solution de fortune visant à pallier les lacunes d’Adam blessé par le péché originel, mais elle peut faire oublier ces lacunes, et jusqu’au péché lui-même. L’individu se confondra alors avec son uniforme, son métier, son rôle social, etc[5]. Cette confusion entre l’artifice et l’essence qu’il permet de manifester est catastrophique. Car les technologies de médiation ne sont jamais infaillibles : elles ne répondent jamais parfaitement aux « questions telluriques » et laissent toujours de côté des « questions-piège » non-couvertes qui seront tôt ou tard utilisées contre elles.
Les défilés nocturnes de drag queen peuvent apparaître comme un « mal » en ce sens qu’ils brouillent et menacent le lien que la société permet d’établir entre le sexe (au sens matériel et tellurique) et le « genre » (au sens d’identité céleste). Mais cette subversion a au moins la vertu d’empêcher les artifices médiateurs de prendre le pas sur le pôle céleste. Elle rappelle que le « genre » social n’est pas le genre au sens dernier, mais n’en est que l’imparfait vaisseau ici-bas. Pour que ces manifestations marginales gardent un sens, cependant, il faut qu’elles demeurent marginales : à la périphérie de la cité, elles rappellent que les murailles ne sont pas inébranlables et qu’il y a un monde au-delà d’elles ; à la tombée du jour, elles rappellent que la bienséance est un effort qui doit être maintenu, révéré, et parfois relâché. C’est pourquoi les êtres ambigus qui ont un pied dans la cité et l’autre dans les terres sauvages, qui se métamorphosent la nuit et cultivent une identité fluide ou insaisissable affectionnent tout particulièrement les énigmes et les questions dérangeantes. Ces interrogations malvenues mettent au défi le voyageur d’employer ses habitudes de pensée pour identifier des cas-limites que ses motifs d’interprétation ne recouvrent pas.
Les questions de la terre
On se rappelle que la question la plus connue du Sphinx concerne précisément l’identité humaine : « Quel animal marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi, et à trois pattes le soir ? » questionne le monstre hybride et androgyne (échappant lui-même aux classifications). Cette question implique la dissolution dans la multiplicité et le changement : il semble impossible d’enfermer dans une définition la créature « fluide » ainsi décrite. Œdipe parvient pourtant à nommer le principe qui unifie cette fluidité, principe qui en fait une substance unie : la créature dont parle le Sphinx, c’est l’homme, qui marche à quatre pattes au matin de sa vie, à deux pattes au midi de sa vie, à trois pattes au soir de sa vie[6]. Se reconnaissant comme « un » malgré la multiplicité de ses états, Œdipe échappe à la dissolution dans le chaos et à la destruction dans l’estomac du sphinx. On voit ici le parallèle qu’il est possible de dresser avec la remise en question des notions de genre par l’approche constructiviste. En proclamant la « fluidité des identités », en présentant des cas-limites inclassables, les individus marginaux qui se proposaient de déconstruire le « genre » soumettaient aux habitants de l’ « espace structuré » une énigme qui ne pouvait être résolue qu’en faisant appel à un principe supérieur. Adam, une fois encore, devait « nommer » une créature, en se faisant l’intermédiaire entre le ciel et la terre. Mais les « technologies » (ou les « normes sociales ») qu’il avait employées jusqu’alors pour l’aider à tenir ce rôle d’intermédiaire étaient devenues absolues, parce qu’elles n’avaient pas été relativisées par une tradition spirituelle. Elles ne purent donc s’adapter à ce nouveau défi, ce qui rendit la médiation impossible.
Le triomphe de la « fluidité des identités » découle ainsi de la perte du « genre céleste » dont la distinction sociale des genres n’est qu’une expression artificielle. Les personnes de bonne volonté qui cherchent à ramener le débat à des questions matérialistes en assimilant le genre à la notion biologique de sexe ne font que réitérer l’erreur qui nous a menés où nous en sommes. Ils demandent à la terre de répondre à ses propres questions. Certes, il serait facile d’affirmer que le genre dépend entièrement du sexe, et que la binarité sexuelle est biologique et tangible, puisqu’elle se fonde exclusivement sur des faits scientifiques. Mais c’est oublier que tout sens vient « d’en-haut » et que la polarité « mâle / femelle » découle elle-même de la polarité « masculin / féminin ». Il faut donc inverser la perspective moderne, comme l’avait compris C. S. Lewis :
On ne peut affirmer que le genre soit une extension imaginaire du sexe. La vérité est inverse : le genre est une réalité, et une réalité plus fondamentale que le sexe. Le sexe n’est en réalité que l’adaptation à la vie organique d’une polarité fondamentale qui divise tous les êtres créés. Le sexe féminin est simplement une chose féminine parmi beaucoup d’autres […]. Les sexes mâle et femelle des créatures organiques sont de pâles et troubles reflets du masculin et du féminin. Leurs fonctions reproductives, leurs différences de force et de taille, expriment en partie, mais troublent et déforment, la polarité réelle.
Lewis parle ici manifestement du « genre métaphysique », dont le « genre social », indéfiniment déconstruit et reconstruit par les sociologues, n’est que le canal. Si, au nom d’un bon sens dépourvu de fondations spirituelles, les conservateurs refusent la primauté de ce genre métaphysique, ils assisteront impuissant à l’abolition du genre social et même, dans un avenir plus ou moins proche, à l’abolition du sexe.[7] Il est tentant de soutenir, avec Walsh et d’autres, qu’une femme est simplement « une femelle humaine adulte » ou plus précisément un être humain dont le corps est ordonné à la production de certains gamètes. Mais la distinction terre/ciel est fractale, et si l’on est déterminé à renoncer au ciel, on pourra le chasser indéfiniment des éléments telluriques qu’on a cru mettre à jour. En l’occurrence, l’idée qu’un corps soit ordonné à une fin implique déjà une téléologie, donc un principe et une hiérarchie : et si cette hiérarchie n’est pas proclamée et reconnue, d’astucieux philosophes pourront toujours contester le jugement du bon sens. On pourra ainsi voir dans l’assignation d’une fonction à un corps l’expression d’une norme arbitraire ou la projection d’un désir de contrôle. On désignera, une fois encore, des cas-limites : la stérilité, la ménopause, l’hermaphrodisme, etc. Ce genre de débat est infini. Dès qu’on veut affirmer un « fait » sans référence au sens qui le fonde (une « terre » sans référence au « ciel »), un philosophe post-moderne peut surgir de n’importe où pour s’emparer de ce fait supposé et le réduire à l’accumulation arbitraire et contingente de ses éléments constitutifs. À ce rythme, si l’on ne réaffirme pas la nécessité de la médiation adamique entre les questions de la terre et les réponses du ciel, la notion d’identité individuelle elle-même pourrait bien perdre tout son sens.[8]

L’invasion du centre
Le problème vient de ce que le sphinx n’est plus assis la sortie de Thèbes. Il siège sur le trône de Créon. Ne pouvant s’unir sous un principe, la fluidité a fait loi (au sens le plus strict parfois). Faisant loi, elle a pris position à l’intérieur, et même au centre, de l’espace structuré. C’est d’elle, à présent, qu’on attend des réponses, et c’est elle qui doit faire face aux « questions-pièges ». Or, la « terre » n’est pas faite pour répondre aux questions, mais pour les poser.
Symboliquement parlant, l’approche « constructiviste » est un serpent subtil qui menace l’espace stable et l’oblige à se renouveler. Dans la genèse, la première parole du serpent est d’ailleurs une question : « Dieu a-t-il réellement dit :Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (Gen 3). S’introduisant dans les murailles fissurées de la société moderne, profitant de son incapacité à fonder métaphysiquement ses propres définitions, les philosophes ophidiens subvertirent les vieilles conceptions « bourgeoises », jusqu’à exercer leur influence au plus haut niveau de la société.[9]
Mais le constructiviste, érigé en législateur, se trouve dans une position délicate. Une philosophie traditionnelle multiplie les conséquences et les ramifications de principes révélés ou transmis. Une philosophie « déconstructrice », en revanche, ne peut que diviser indéfiniment les objets qui lui sont présentés, revenant sans cesse à elle-même pour s’autodétruire et renaître, comme le serpent ouroboros. Naturellement incapable de développer des concepts à partir de principes et de bâtir sur eux une construction solide, une telle philosophie ne peut qu’en dernier lieu revenir sur soi et se nier en s’affirmant. Les réponses circulaires et auto-contradictoires de la déconstruction peuvent certes donner l’illusion d’une création positive ; mais cette fausse création se divise à l’infini au lieu de se multiplier. Ce n’est pas un arbre, c’est un serpent insaisissable se faisant passer pour un arbre. Cette image étrange est parfaitement représentée par l’hydre, dont les têtes se multiplient lorsqu’on les coupe. Produisant les questions plus vite que les réponses, l’hydre qui siège en juge de la société post-moderne se multiplie indéfiniment et ne peut être détruite par le raisonnement analytique, puisqu’elle-même est destruction analytique[10]. Elle est ce mouvement d’analyse qui consiste à réduire une chose à la somme de ses parties. Elle ne peut donc créer de nouvelles identité. La façon dont les catégories post-modernes se déconstruisent continuellement en sous-catégories jusqu’à constituer une multiplicité liquide et chaotique illustre parfaitement ce mouvement. Les tentatives de réponse à la question de Walsh aussi.
Inévitablement, les personnes interrogées répondent par des questions (« Pourquoi posez-vous cette question ? ») par des affirmations circulaires (« Une femme est quelqu’un qui dit être une femme et devient une femme »), ou en invoquant une multiplicité indéfinie (« [Le mot « femme »] signifie beaucoup de choses différentes pour beaucoup de gens différents »). On retrouve dans ces trois types de réaction les questionnements du tentateur, l’autophagie de l’ouroboros, et la division perpétuelle de l’hydre – mais nulle part la solidité de l’arbre qui porte des fruits.

Les questions du ciel
Sans une pratique spirituelle dépassant et fondant les artifices médiateurs, ceux-ci menacent toujours d’usurper la primauté du principe céleste et d’être ensuite détruits par les forces telluriques marginales. Seule une foi profonde (car le principe premier nous échappe toujours) permet un recours sain à la médiation artificielle. Sans cette foi, les artifices deviendront des idoles et s’écrouleront, entraînant la société avec eux. « Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n’entendent pas » : ces versets décrivant les idoles païennes pourraient très bien s’appliquer aux vieilles habitudes de pensée, à la « rigueur scientifique », à la « quête d’objectivité » invoquées pour nous sauver de la « folie woke ».
On comprend désormais pourquoi de nombreuses spiritualités ont recours à des « questions-pièges » permettant de relativiser la médiation artificielle. Les questions dérangeantes brisent les motifs organisés de la pensée et amènent ainsi le disciple à reconnaître un monde qui le dépasse en dehors de ses concepts habituels. Ces questions peuvent avoir un but « positif » ou « négatif ». Dans la perspective positive, la question sert à démontrer que les difficultés ne sont qu’apparentes, et que derrière les questionnements sans cesse renouvelés de la terre se trouve la Grâce, qui peut toujours suppléer aux déficiences de la médiation adamique, fût-ce de manière dissimulée et indirecte. C’est ce qu’on voit dans cette histoire juive rapportée par Adin Stenzalt dans son Introduction au Talmud :
Une anecdote raconte qu’à la suite de malheurs personnels, un sage sentit sa foi faiblir et demanda conseil à l’un des grands maîtres de son temps. Celui-ci lui posa une question difficile extraite des tossafot, à laquelle le sage répondit correctement. Le maître lui posa alors une autre question, que son interlocuteur résolut également. Ils continuèrent ainsi pendant un certain temps jusqu’à ce que le maître déclare : « Tu vois, les tossafotsont la vérité, en dépit des problèmes qu’elles soulèvent ; et le Saint, béni soit-il, est aussi la vérité, en dépit de nos doutes et de nos problèmes. »
Dans la perspective négative, le questionnement rappelle que les machinations post-lapsaires d’Adam ne concilieront jamais seules les « informations » venues du ciel et les « faits bruts » de la terre, car rien ne peut recouvrir l’indéfini terrestre, si ce n’est l’infini céleste. Ainsi, un koan zen rapporte qu’un jeune moine fut questionné par son maître à propos d’une cruche. « Cette cruche est-elle réelle ? », demanda son maître. En répondant par la négative, l’élève aurait nié l’immédiateté de son expérience pour satisfaire à une philosophie, une construction mentale artificielle apprise par cœur. Mais en répondant par l’affirmative, il aurait nié le caractère fugace et illusoire de toute chose, enseignement sacré de sa tradition, pour honorer l’existence d’une simple cruche. Ses catégorisations internes ne lui permettaient pas de répondre à la question. Alors l’élève les fit voler en éclat en brisant la cruche.
Ces deux approches n’en sont qu’une. L’énigme insoluble « relève les humbles et jette à bas les puissants de leur trône » au sens où elle humilie le présomptueux et réconforte le désespéré : c’est par des questions, et non par des réponses, que Dieu guérit Job à la fois de son affliction et de son orgueil. Un individu peut être victime des technologies de médiation de deux façons : en s’y intégrant trop parfaitement ou en ne s’y intégrant pas du tout. En relativisant ces technologies, en rappelant le péché originel et les limites de l’humanité déchue, la question insoluble rend l’espoir à l’exclu et la crainte à l’arrogant. « Les questions de Dieu sont plus satisfaisantes que les réponses des hommes », écrivait Chesterton dans sa préface au Livre de Job.
Et de fait, le ciel peut répondre à toutes les questions de la terre, même si c’est parfois de manière mystérieuse et indirecte. L’inverse n’est pas vrai. L’archange Saint Michel, en demandant au serpent « Qui est comme Dieu ? », pose la dernière question. La terre, après le péché originel et la défaillance des médiations artificielles, est partiellement privée de l’information céleste révélée. Elle est ainsi tentée de chercher en soi sa forme et son sens. L’homme oublie qu’il ne peut trouver l’identité des choses en elles-mêmes, et partant, qu’il ne peut trouver sa propre identité en lui-même. Il oublie qu’un objet est plus qu’une collection d’atomes, qu’un morceau de viande parcouru de signaux électriques, il oublie que son être véritable est un mystère insondable. C’est le sens des questions posées à Job, et de la question posée par Saint Michel. En restant muet devant Dieu, Job peut retrouver espoir en la Grâce. En se reconnaissant incapable de répondre à Saint Michel, le monde marginal non-couvert par la médiation artificielle peut à nouveau prétendre chercher son identité hors de soi-même, en Dieu – fût-ce de manière indirecte. Par l’humilité qu’inspire la question de l’archange, les vérités inatteignables cessent d’être des anomalies scientifiques ou sémantiques auxquelles nous pourrions inventer une réponse, et elles apparaissent comme ce qu’elles sont : des mystères.

Linked Articles & Posts
Linked Premium Articles & Posts
[1] Nous laisserons de côté, pour les besoins de l’article, les nombreuses autres catégories de genre considérées comme légitimes par le mouvement LGBT.
[2] « Tu me définis, tu me nie » aurait dit Kierkegaard.
[3] Cette conclusion semble inévitable. Il nous semble que ce qu’on appelle aujourd’hui « transphobie » n’est que l’expression d’une frustration croissante face à une logique manifestement déficiente que les militants cherchent à faire passer pour la seule acceptable. Certains milieux non-conservateurs reconnaissent eux-mêmes l’aporie. Les « abolitionnistes du genre » estiment ainsi que toute notion de genre doit être éliminée du discours public. Certaines féministes radicales, au contraire, estiment que la conclusion étant inacceptable, il faut en rejeter les prémices : elles refusent donc de considérer un « homme biologique » comme une femme. Aux États-Unis, au Canada et en France, la jeune gauche accepte en général les prémisses tout en rejetant la conclusion.
[4] Plusieurs exemples assez clairs de ce cas de figure apparaissent dans la société actuelle : des manifestations de masculinité ou de féminité agressives côtoient des êtres relativement asexués. Andrew Tate et Judith Butler sont tous deux nés du « Grand divorce du ciel et de la terre ».
[5] En peinture, c’est ce qui arrive avec l’art pour l’art, puis l’art abstrait, où la peinture « se suffit à elle-même », en philosophie, c’est le « tournant sémantique » où l’outil du logos est pris pour le Logos lui-même, en religion c’est le formalisme, où l’orthopraxie remplace l’orthodoxie. Mais c’est aussi l’erreur de l’avare qui prend la fin pour le moyen, ou de l’idéologue, qui accepte pour faire triompher sa théorie de mettre à sac la société qu’elle est censée sauver.
[6] Rappelons ici le symbolisme de la tête comme « principe » (ciel) et des membres comme « extension et soutien du principe » (terre). Toute cette réflexion est inspirée par celle de Matthieu Pageau dans The Secrets of God’s Dog.
[7] A supposer que le transhumanisme triomphe un jour, il est peu probable qu’il prenne longtemps en compte les différences de genre et de sexe. Mais sans aller si loin, rappelons que la culture et l’environnement affectent aussi le développement biologique des individus.
[8] On voit déjà apparaître chez certains jeunes un intérêt étrange et morbide pour les troubles dissociatifs de l’identité (dits aussi « troubles de la personnalité multiple ».
[9] On fait généralement remonter le « wokisme » à la déconstruction française des années soixante, mais il nous semble que le même phénomène se retrouve partout où la pratique spirituelle est négligée ou réprimée. On peut citer Lénine, qui en 1917 déclarait que le but de la révolution était la révolution elle-même : le principe censé renouveler l’espace structuré se retrouvant souverain, il n’y a plus rien à renouveler, et une autodestruction perpétuelle s’ensuit.
[10] Le symbolisme du dragon est proche de celui de l’eau – et c’est encore plus vrai de l’hydre, dont le nom signifie « eau » en grec. A ce titre, combattre l’hydre de la déconstruction avec l’épée de la raison revient littéralement à « donner des coups d’épée dans l’eau ».
MEMBERSHIP
Join our Symbolic World community today and enjoy free access to community forums, premium content, and exclusive offers.


.svg)



.svg.png)
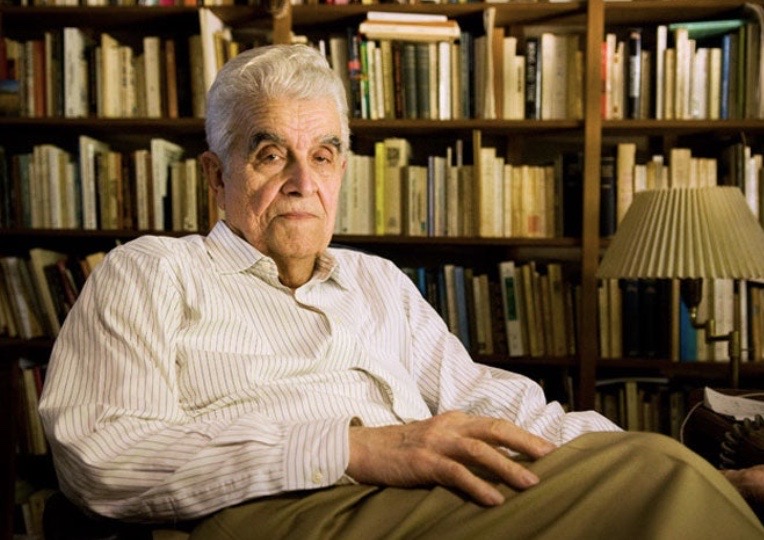


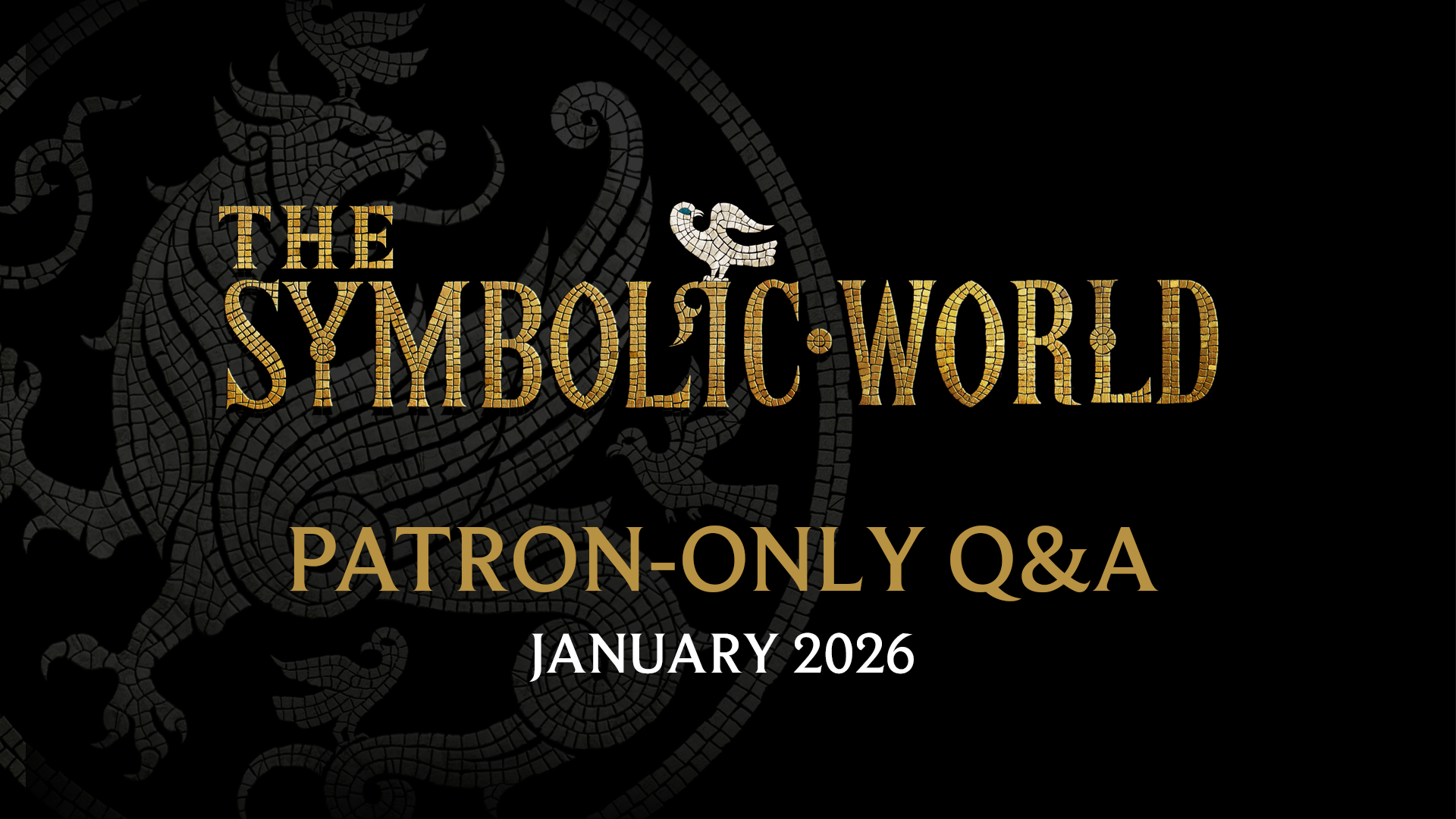


Comments