
Introduction
Marc Augé a étudié l’espace moderne urbain dans son livre Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité[1], où cet ethnologue français postule un concept permettant de rendre compte de l’espace tel qu’il se construit dans les villes : « Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu. »[2] Le lieu anthropologique est identitaire parce qu’il est significatif (il est porteur de sens) et permet un sentiment d’appartenance; le lieu est relationnel parce que nous y cultivons une relation de socialisation au sens fort du terme, c’est-à-dire que le lieu permet d’inscrire les représentations sociales dans le monde matériel; le lieu est historique parce qu’il a son histoire (personnelle ou commune) qui l’inscrit dans une suite de lieux, une suite culturelle qui sert de référent commun dans une fresque du temps.
Le non-lieu chez Augé n’a pas ces attributs car il offre seulement un accès à la consommation de son utilité : le non-lieu est hors du schéma de socialisation car il est vide, entre deux. Augé donne comme exemple de non-lieux les aéroports, les gares, les autoroutes, mais aussi des endroits « habités » sans être investis culturellement comme les camps de réfugiés. Ce qui distingue ce dernier cas d’un véritable lieu, c’est que celui-ci n’est pas approprié, n’est pas symbolisé. Pour faire un parallèle, nous pourrions dire que le lieu, c’est ce qui est « cosmisé » (voir Eliade à ce sujet) par la culture qui l'assume afin de le rendre symboliquement habitable à partir d’un cadre référentiel donné. C’est pour cette raison que les gens qui échappent à la sociabilité, comme les sans-abris (que nous pourrions appeler des « sans-lieux »), vivent dans ces endroits.
Pour Augé, les non-lieux sont flous, passagers, non symbolisés (ou présymbolisés). Ce qui rend le non-lieu intéressant, c’est qu’il crée un espace de virtualité où, n’ayant pas d’attachements, l’individu peut percevoir le non-perçu. Bien entendu, dans la vie de tous les jours, les gens marchent, par exemple, dans le métro souterrain en mode automatique, justement parce qu’ils laissent la physicalité (purement utilitariste) les contrôler. Le non-lieu peut devenir un lieu de possibilités pour celui qui sait les reconnaître.
L’anthropologisation d’un lieu est une démarche humaine, symbolisatrice, qui tire ses racines d’une perspective spirituelle et cosmique: pour s’orienter, il faut un repère. En d’autres mots, il est tout à fait humain d’organiser le monde, notamment parce que Dieu, dans la création, organise le monde. Il fait du monde matériel un endroit symbolisé à l’image d’un temple. Aussi, cet article examinera-t-il en particulier un exemple de la transformation symbolique d’un non-lieu, soit la mise en sol de la Croix de Gaspé lors du voyage de Jacques Cartier.
Symbolisation de l’espace: démarche spirituelle
Le XXIIIIme jour dudict moys, nous fismes faire vne croix, de trente piedz de hault, qui fut facte devant plusieurs d’eulx, sur la poincte de l’entrée dudit hable, soubz le croysillon de laquelle mismes vng escusson en bosse, à trois fleurs de lvs, et dessus, vng escripteau en boys, engravé en grosse lettre de forme, où il y avait, Vive le Roy de France. […] Et après qu’elle fut eslevé en l’air, nous mismes tous à genoulx, les mains joinctes, en adorant icelle devant eulx, et leur fismes signe, regardant et leur monstrant le ciel, que par icelle estoit nostre redemption, dequoy ilz firent plusieurs admyradtions en tournant et regardant icelle croix.
– Jacques Cartier
Nous disons spirituelle parce que cette démarche tend à vouloir sacraliser (sacer, mettre à part) l’univers par l’intervention des modèles primordiaux, donné par les ancêtres, les dieux, les mythes. Si Jacques Cartier a planté une croix à Gaspé pour marquer ainsi le territoire au nom du roi François Ier, il l’a fait selon une coutume ancienne. L’utilisation de la croix s’est révélée par l’incarnation du Christ comme le symbole de sanctification par excellence - l’endroit et le moment (le vertical et l’horizontal) où le monde renaît. Ceci dit, la sanctification d’un lieu par l’intervention symbolique chargée d’un numen n’est pas nouvelle; ses éléments existent dans la plupart des sociétés traditionnelles, comme Mircea Eliade l’a démontré dans son étude sur le concept de l’axis mundi.
Spirituelle aussi parce que le geste possède une efficacité symbolique qui rend compte d’une réalité autre, que Jacques Cartier s’en soit rendu compte ou non. En effet, le but premier de Jacques Cartier était d’organiser une expédition afin de « descouvrir certaines yles et pays où l’on dit qu’il se doibt trouver grant quantité d’or et autres riches choses », sur ordre du roi. Cela dit, l’acte accompli comportait sa propre efficacité, et eut des échos dans la structure de pensée des Canadiens français en cristallisant cette idée que l’Amérique du Nord était bel et bien une terre du Christ. L’acte lui-même d’exploration renvoie à une perspective métaphysique bien précise que nous n’allons pas aborder plus avant ici, sauf pour dire qu’elle est en lien avec son époque historique, en tant que projection des énergies de l’humain vers un extérieur toujours croissant, tendant à terme à une entropie collective.
Symbolisation de l’espace: démarche cosmique
On ne devient homme véritable qu’en se conformant à l’enseignement des mythes, en imitant les dieux.
– Mircea Eliade
Le but d’une telle démarche de la part des Européens - portée par la tradition indo-européenne qui les accompagnait depuis des millénaires mais aussi à l’image du Dieu créateur de la Bible - était avant tout d’imprimer au chaos un ordre, c’est-à-dire de transformer une terre « sauvage » en cosmos. Au niveau inférieur, c’est-à-dire matériel, c’est l’organisation du territoire : la croix représentait le premier espace chrétien de la nouvelle terre, à partir duquel une « Nouvelle France » pourrait se constituer. Plus encore, c’est ce qui donna le coup d’envoi à une colonisation et à la construction des schémas urbains et ruraux d’habitation : car il fallait une « pierre angulaire », une marque première, pour que tout le reste puisse se déployer.
À des niveaux plus élevés, cette construction d’un cosmos permettait aussi une relation avec le territoire et ses habitants. Les conséquences de cette relation furent certes souvent déplaisantes, notamment en lien avec les idéaux prosélytes et impérialistes de l’époque; mais ce qui nous intéresse ici, c’est plutôt la structure symbolique d’ouverture derrière cette démarche.
Conclusion
Les colons scandinaves, en prenant possession de l’Islande (land-nâma) et en la défrichant, ne considéraient cette entreprise ni comme une œuvre originale, ni comme un travail humain et profane. Pour eux, leur labeur n’était que la répétition d’un acte primordial, la transformation du Chaos en Cosmos par l’acte divin de la Création.
– Mircea Eliade
Le geste symbolique est d’une portée considérable, et ce texte, bien qu’extrêmement court, montre les potentialités d’un tel acte qui, à certains égards, ont échappé à son auteur. Ce que Jacques Cartier a fait, c’est de cosmiser la Nouvelle-France du point de vue de la structure collective des Canadiens français, en transformant la terre nouvelle en un lieu anthropologiquement chrétien.
Afin de mieux comprendre les perspectives qui se dressent derrière cette interprétation, nous invitons le lecteur à lire Mircea Eliade sur l’axis mundi, ainsi qu’à méditer les ramifications sous-jacentes d’un acte puissant d’établissement symbolique d’un cosmos sur une nouvelle terre, tel qu’en offrait déjà l'exemple l’empereur Constantin en fondant à Byzance une “Nouvelle Rome”, qu’il appellera Constantinople.[3]
Linked Articles & Posts
Linked Premium Articles & Posts
[1] Seuil, 1992
[2] Augé, Seuil, 1992, p. 100
[3] Mario Baghos, From the Ancient Near East to Christian Byzantium, 2021
MEMBERSHIP
Join our Symbolic World community today and enjoy free access to community forums, premium content, and exclusive offers.


.svg)



.svg.png)
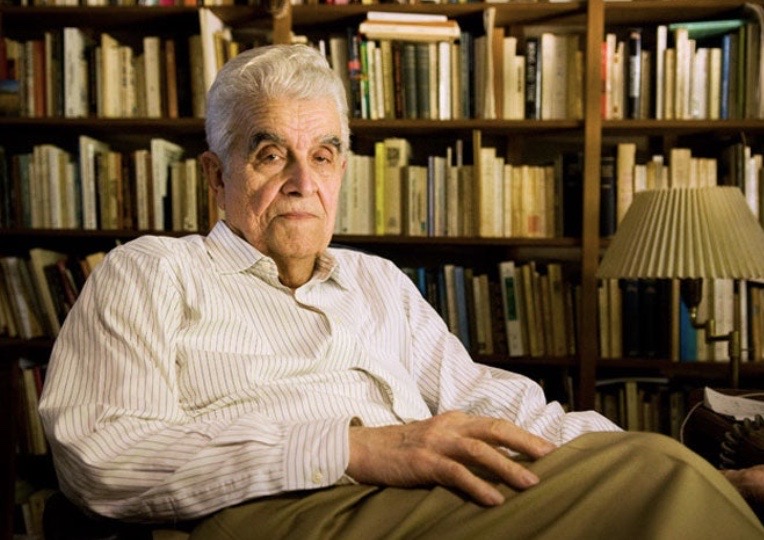


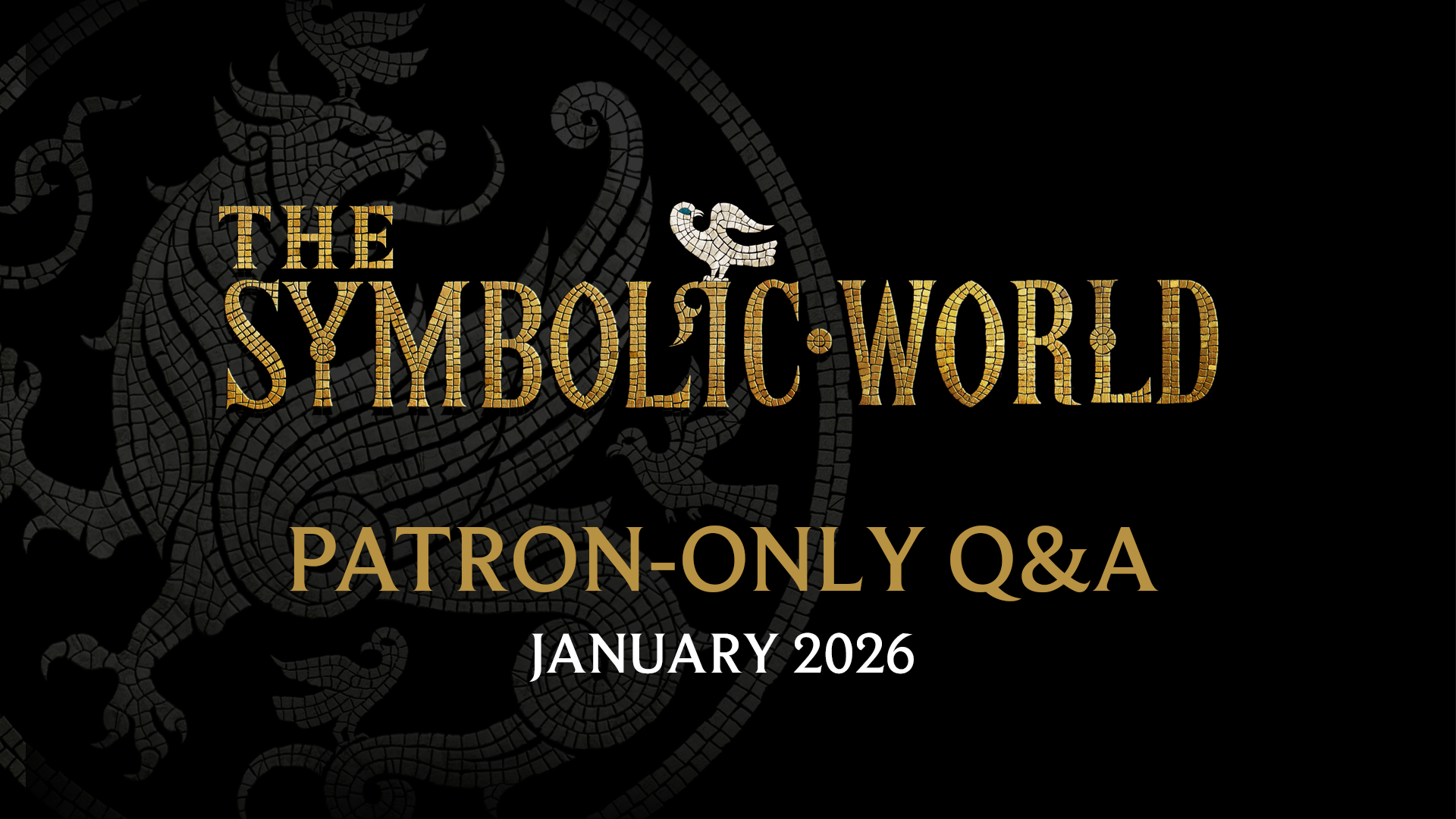
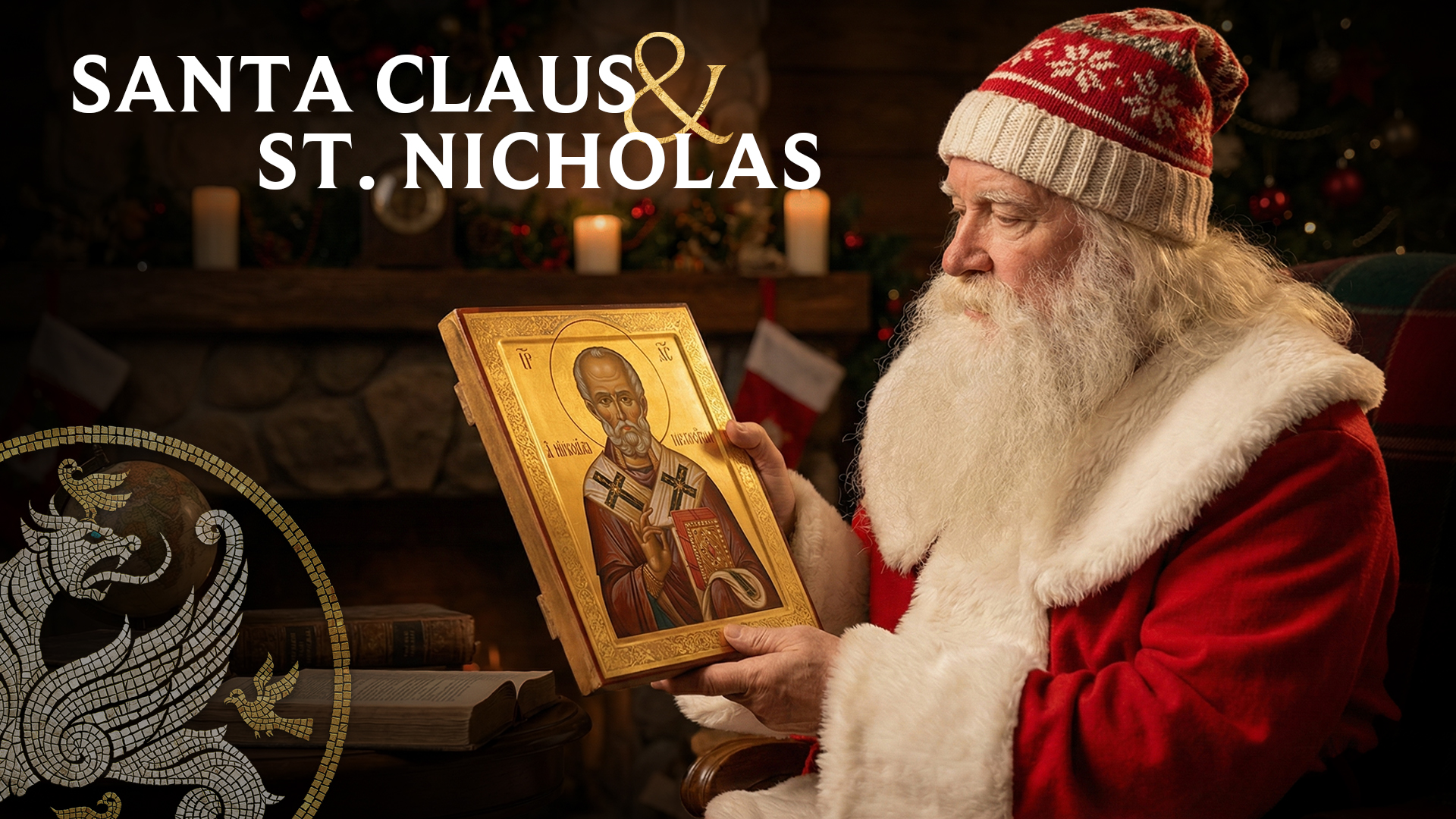

Comments